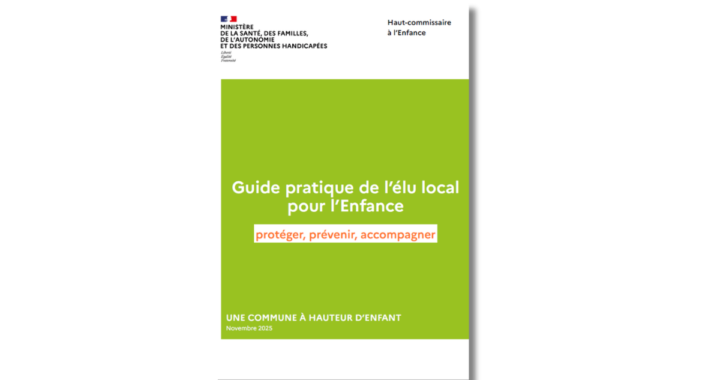Le gouvernement a présenté le 21 novembre, en marge du Congrès des maires, un nouveau Guide pratique de l’élu local pour l’Enfance. Un document soigné, riche, abondamment illustré, qui ambitionne d’accompagner les communes dans un champ devenu stratégique : petite enfance, périscolaire, mobilités, restauration, participation des jeunes.
Sur le papier, l’outil semble complet. Mais une question traverse immédiatement les élus : à quoi sert un guide, si les moyens pour appliquer ce qu’il recommande ne suivent pas ?
Depuis des mois, les maires alertent sur la mécanique qui s’installe : des compétences élargies, un niveau d’exigence renforcé, et des financements qui ne progressent pas au même rythme. Le Service public de la petite enfance, entré en vigueur en janvier, en est l’illustration la plus évidente. Le guide en détaille les contours, les obligations, les partenariats possibles, mais il ne corrige pas une injustice que les communes constatent chaque jour : seules une partie d’entre elles bénéficieront d’un soutien financier réellement utile, quand d’autres, pourtant concernées, n’auront rien.
Le document encourage une approche globale de l’enfant, de la crèche au collège, du square à la cantine. C’est l’un de ses points forts : il rompt avec la vision en silos, il incite les territoires à construire une continuité éducative. Les exemples cités sont souvent inspirants. On lit des expériences autour du jeu libre, de l’apprentissage de la citoyenneté, de la prévention ou de l’accès à la culture.
Mais derrière ces bonnes pratiques, un même impensé revient, presque ligne après ligne : comment une commune peut-elle réellement renforcer sa politique de l’enfance si les charges s’accumulent sans garantie d’une compensation stable ?
Ce que le guide aborde moins frontalement, ce sont les réalités auxquelles les maires se heurtent déjà :
– des équipes fragilisées par la pénurie de professionnels ;
– des gestionnaires d’établissements sous tension ;
– des structures d’accueil qui peinent à recruter ;
– des dépenses incompressibles en hausse ;
– des injonctions nationales parfois contraires aux capacités locales.
Il n’évoque pas davantage la question des critères de répartition de l’accompagnement financier pour le SPPE, contestés dans de nombreuses communes parce qu’ils ne prennent ni en compte le nombre d’enfants concernés ni la situation sociale des familles. Un point pourtant central pour éviter que la politique de l’enfance ne devienne, une fois encore, une politique à deux vitesses.
Cela ne signifie pas que le guide soit inutile. Il clarifie, il rassemble, il synthétise. Certaines collectivités y trouveront des repères précieux. Mais la distance reste grande entre ce que le document esquisse et ce que les maires doivent assumer. Les collectivités ne demandent pas d’être éclairées sur ce qu’il faudrait faire : elles savent déjà où elles doivent aller. Elles demandent que l’État tienne sa place et finance, enfin, à hauteur de l’ambition qu’il affiche.
Il faut reconnaître au Haut-commissariat à l’enfance une volonté d’ordonner un champ devenu complexe. Mais aucun manuel ne compensera l’absence d’une stratégie nationale solide, lisible et stable. C’est ce cap que les élus attendent désormais : une politique de l’enfance qui ne se contente pas d’être pensée, mais qui puisse être mise en œuvre partout, et pas seulement là où les moyens le permettent.
Les élus ne s’y tromperont pas : l’enfance ne manque plus de guides, de stratégies, ni de chartes. Ce qui manque encore, ce sont les moyens pour que ces documents ne restent pas dans un tiroir.
Pour aller plus loin : Retrouvez ci-dessous le guide pratique dans sa version feuilletable.