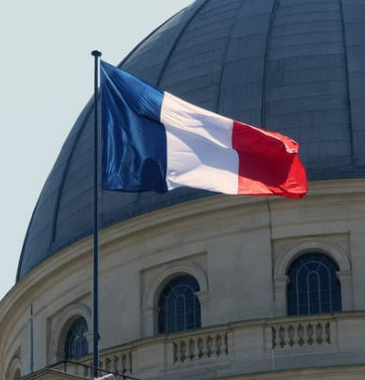Le gouvernement s’apprête à demander un nouvel effort aux collectivités dans le cadre du budget 2026. Pour en justifier la nécessité, certains remettent en avant l’argument d’une simplification des normes. Sous couvert de pragmatisme, la majorité sénatoriale laisse entendre que cet allègement réglementaire permettrait de dégager des économies substantielles. Une façon commode, pour beaucoup, de détourner l’attention des responsabilités de l’État. Ce raisonnement se déploie alors même que l’exécutif envisage de demander 8 milliards d’euros d’économies supplémentaires aux collectivités. Plutôt que d’assumer clairement une politique de recentralisation austéritaire, la majorité sénatoriale pousse l’idée selon laquelle la simplification des normes pourrait suffire à rétablir les comptes publics.
C’est dans ce contexte que Gérard Larcher a défendu, sur BFMTV, l’idée d’une « piste d’économies indolore », en pointant le coût des normes imposées aux collectivités, qu’il estime à plus de 5 milliards d’euros sur deux ans. Un argument qu’il avait déjà avancé devant les maires en novembre dernier. Alléger le « carcan normatif » permettrait, selon lui, de relâcher la pression budgétaire.
Ce discours séduit la droite, qui y voit une manière d’éviter le débat sur la fiscalité locale. Dans la foulée, le ministre de l’Aménagement du territoire, François Rebsamen, a présenté lundi une initiative baptisée « Roquelaure de la simplification », censée faciliter l’urbanisme et débloquer certains projets. Le gouvernement appuie également cette orientation législative : une proposition de loi du groupe LIOT, soutenue par l’exécutif, vise à alléger certaines obligations environnementales ou à simplifier les modifications de PLU.
Cette dynamique est également à l’œuvre au Sénat, où une mission d’information a donné lieu à un texte porté par des sénateurs de droite et du centre, visant à renforcer le pouvoir préfectoral de dérogation. L’idée : adapter les normes au terrain. François Bayrou s’y est rallié, dans une vision très verticale de l’État régulateur.
Mais au sein du groupe socialiste, la prudence demeure. Simon Uzenat, sénateur du Morbihan, estime que les économies réellement exigées des collectivités dépassent les 7 milliards d’euros, une fois intégrés le gel de la dynamique de TVA et la baisse du Fonds vert. Reprenant les chiffres avancés par André Laignel, il évoque un excès normatif bien réel, tout en mettant en garde contre une dérive libérale qui réduirait ces normes à de simples charges, oubliant leur rôle dans la régulation, la cohésion sociale ou la protection des biens communs. Cette mise en garde mérite d’être entendue. Sans encadrement rigoureux, la remise en cause des normes pourrait compromettre des objectifs fondamentaux de sécurité, de solidarité ou de transition écologique.
D’autant que derrière cette opération de communication sur les normes, c’est bien la question des moyens qui émerge. Deux ans après la suppression totale de la taxe d’habitation, Gérard Larcher lui-même reconnaît que « la fiscalité locale ne peut reposer uniquement sur les propriétaires ». Mais l’exécutif, tout en brandissant le principe d’un « nouvel effort partagé », refuse pour l’instant de rouvrir le débat sur de nouveaux leviers fiscaux pour les collectivités.
Les élus locaux ne sont pas dupes. Comme le rappelle Simon Uzenat, « il faut arrêter de faire croire que la puissance publique peut faire mieux avec moins ». L’autonomie financière des collectivités, leur capacité d’action, ne peuvent être sacrifiées sur l’autel des normes ou de l’habillage technocratique. La question de la fiscalité locale mérite un vrai débat démocratique.
À travers ce débat sur les normes, c’est une vision de l’action publique qui s’affirme : celle d’un État qui transfère ses responsabilités sans garantir les moyens de les assumer. Le moment est venu de reposer clairement la question des ressources, du respect des engagements de l’État et de la place des collectivités dans la République.
Source : Public Sénat, 2 mai 2025.